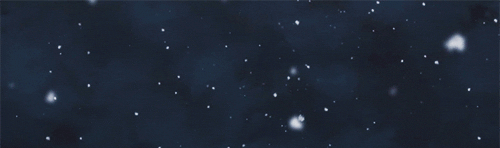˻ Dilution ˺
Feat — Nora Lockwood
Ici j’écris. J’écris comme une thérapie-souvenir d’abord. Pour guérir, et pour ne pas perdre les morceaux de mémoire qui circulent dans mon esprit, comme des chiens errants. J’ai vu de nombreuses lumières et ombres, et une musique douce écoutée dans la tête car je suis. Mort mort mort encore de nombreuses fois. Alors j’écris, pour ne pas perdre le sens des mots automatiques qui sont autant de morceaux de souvenirs qui tentent l’échappatoire, mais je veille. Je veille un peu triste en gardien et en porte et en clé dissimulée, et je grave, je grave sur la pierre creuse du papier avec l’encre, les morceaux de souvenirs échappés. Tu vois (et je m’adresse à une personne imaginaire sur le papier, c’est bien, cela m’aide à catalyser ma panique) ; tu vois, il y a le bruit des embruns et la mer salée, le chlore et l’iode et la mousse blanche (l’écume, c’est le mot que je cherchais), la mousse blanque qui transperce l’onde de l’eau et devance le lourd squelette des bateaux. Je les vois comme de grosses baleines pesantes qui rentrent chez eux. Ici, c’est calme. C’est bien : mes cauchemars sont moins terrifiants. Parfois, je dors. Un peu. Tu vois, sur les chalutiers, il y a les hommes. Ce sont des islandais sauvages, ils sentent le sel et la terre gelée. Tu vois, dans le ciel dégagé du matin, les lumières troubles et vibratoires. C’est le moment de l’aurore, le moment figé, tu vois. Ici, j’écris : j’écris sur l’aurore et sur l’os des baleines, la coque des bateaux et le bois mouillé et humide, à la peinture rouge écaillée. Ici, j’écris, et je m’impose de souffler doucement, pour exhaler doucement de la brume et en même temps doucement mon cœur qui bat (mon nouveau cœur joli et neuf) mon joli cœur doucement vivant cruellement vivant et mes mains tremblent encore.
Mon nouveau cœur est un cœur triste, parce qu’il est porteur d’une grande colère vaine. La colère de la malchance et de la mauvaise fortune, la colère de Sisyphe et sa pierre, montant une montagne éternelle.
Si l’homme est pourtant plutôt jeune, il paraît être vieux. Ses cheveux, gris, sont sales et délavés, et paraissent décolorés sous le prisme du soleil islandais qui éclate sous le dôme de l’aurore. Boréale, et les photons s’agitent sous la coupe du monde. Cyclamën marche silencieusement dans les rues de la grande ville endormie. Il a une grosse écharpe de laine rêche autour du cou, un peu miteuse et vaguement bleu ou bien violet. Indigo. C’est le nom de la couleur que l’écharpe possède en théorie. Dans le ciel, en plus des aurores polychromates et inspirantes, il y a les mouettes et les cris des oiseaux et les nuages solitaires. Les pas de l’écrivain le conduisent — en mécanique bien huilée — vers le port. C’est comme ça : c’est devenu un quasi petit rituel depuis sa « retraite » toute relative. Retraite thérapeutique et désertion faussée. Le matin, il se lève (il a une petite chambre dans une auberge de la grande ville) et il erre dans les rues endormies des humains, et ses pas le conduisent vers le port. Là, souvent, il s’assoit dans un coin, et il observe les marins rentrer et partir vers le large. Il dissèque les vies des pécheurs, silencieusement, et divague. Il oublie et se souvient : bref, il joue son rôle, il regrette.
Parfois, il écrit, sur un petit bloc-notes. Des idées. Des phrases. Il aimerait bien écrire un roman.
L’Autre lui, se tait. Il ne parle plus, et c’est tant mieux. C’est le calme après la tempête, la dictature du silence et du vide. C’est effrayant et libérateur, terrible et risible. Cyclamën évite de trop y penser, de façon générale. Aujourd’hui, le garçon a amené une pomme. Il la croque : ces mains sont maigres et son corps encore plus. Les traits de son visage sont tirés et taillés en une sorte de neige un peu lasse et un peu mélancolique, une neige pessimiste et vaincue sans se battre. Il a les yeux rouges, rouges comme le soleil timide du matin, un rouge qui tend à s’effacer et à disparaitre, et d’ailleurs, on pourrait croire que c’est tout l’être qui cherche à s’effacer et à disparaitre tant l’homme fait des efforts pour ne pas se faire remarquer ni faire de bruit. Il ressemble à un grand héron maladroit et courbaturé. Là, il épluche sa pomme.
Parfois, il y a des monstres-machines aussi, sur le port. Lui, il les regarde, silencieusement. Il n’aide personne. Il mange sa pomme. Et la mer devient rouge alors, un rouge qui tend à vouloir disparaitre et à vouloir s’effacer, comme les yeux du Cyclamën.
Parce que tu vois, je suis las. De disperser et de détruire, de protéger et de dissoudre. Je suis las des fantômes et des ombres, de la matière corrosive et de la machine cliquetante. Alors je regarde et je laisse faire. Et parfois aussi, tu sais, j’ai une grande colère alors. Je brûle et je consume. Je tue et massacre. Sans distinction. Les machines et les humains : l’huile et le sang. Acide comme la pomme découpée le sang. Un pH de très loin très inférieur. Je suis malade, un peu. Un peu fou. Pas de réponse du module d’empathie je crois. Une machine qui avance en boucle, moi aussi, tu sais. J’aimerais beaucoup que l’on m’aide. Mais je n’y crois plus. Je ne crois plus en rien. Bien sûr qu’il y a. Elle. Celle-qui-garde-les-secrets et qui apaise. Je ne crois plus en rien, et j’ai mal à la tête. Tu sais, c’est difficile d’être un vivant. Il y a les fantômes de ceux qui sont morts. Et les regrets de ceux qui sont encore là. Tu as des regrets toi ? Tu m’étonnes. Moi aussi. Normal en même temps. Je suis l’incarné écrivain, la Peste. Le grand malade. Très poétique. Et risible. Oui. L’odeur du sang et du sel et de l’iode, et les reflets des ondes boréales sur l’eau. Tu vois ? Tu as de la chance. Moi, le monde m’a rendu aveugle.
Et les mains tremblantes achèvent de trancher les pelures du fruit. Les pécheurs ont de la chance aujourd’hui. Pas de machine, seulement les mouettes et les poissons et l’odeur de sel. Les hommes rient et sont vivants, ils se déplacent. Cyclamën est sur le quai, les jambes dans le vide, un peu à l’écart. Et dans sa tête doucement, la matrice-grande-colère-fureur augmente. C’est une incantation totem qui doucement le fait glisser vers une genre de violence hypothétique.
Tu vois ? La grande colère rouge qui recouvre tout. Et le sang de la mer qui tend à s’effacer, comme mes yeux. Et le corps des pécheurs sous l’onde boréale de l’aurore, si je décide à céder à la pulsion de la Peste-grande-Colère. L’équilibre et la balance, risibles vies humaines. Tu vois ? Vous me faites tous rires. Vous, ignorants, amnésiques.







































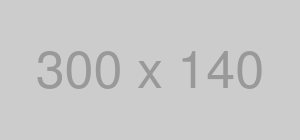




 by anaëlle.
by anaëlle.